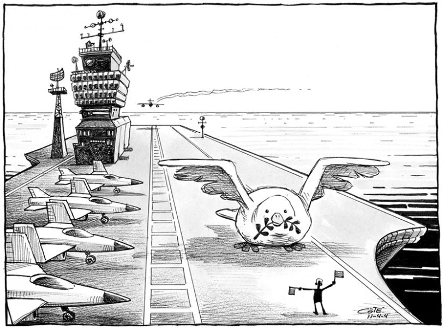La paix est un état d’harmonie et de justice. On associe souvent la paix à l’absence de guerre ou à sa fin. Cependant la guerre est-elle forcément opposée à la paix ? La guerre favorise-t-elle la paix ? Et quel rapport l’humanisme a-t-il avec elle ?
Tout d’abord nos sociétés justifient les guerres comme étant un moyen d’acquérir la paix. La fin de la seconde guerre mondiale fut marquée par la signature de traités et la création d’organisations internationales -telle l’ONU- chargées de consolider la paix et la sécurité et d’éviter de nouveaux conflits. Pour Hegel, la guerre est un “mal nécessaire”, on en aurait besoin pour amener la paix. Mais cette idée est une illusion.
En effet, ces paix d’après-guerre ne sont pas durables, car, souvent, elles sont imposées par l’État gagnant.
Enfin, la guerre en elle-même ne favorise pas la paix, elle s’oppose même à l’humanisme car elle tue des êtres humains. Cependant, certains actes violents, pendant la guerre, peuvent amener à la paix. Un exemple pertinent est celui de la résistance. Les résistants ont commis des actes violents comme le détournement des trains. Bien que cela aille à l’encontre de l’humanisme au départ cela a permis d’arrêter la montée du nazisme, bien plus destructeur et inhumain.
Pour conclure, la guerre en elle-même n’est pas humaniste : elle peut créer des paix nouvelles mais elles ne dureront pas. Face à ces guerres certains actes humanistes peuvent avoir lieu, même si leurs actions au départ peuvent être guerrières.
Chloé Obszynski