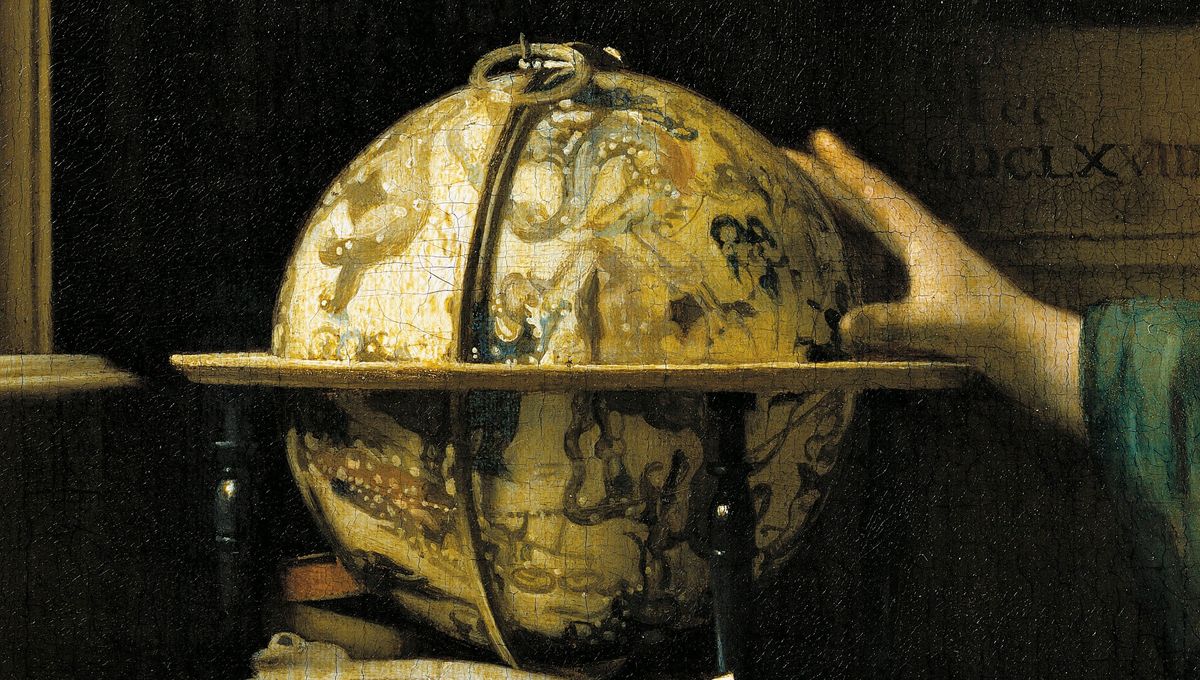Cet article s’inscrit dans un ensemble de réflexions menées depuis la rentrée sur l’Humanisme contemporain. Si, dans « Jusqu’où va le respect ? », nous avions questionné les bornes de l’Humanisme, nous allons ici nous interroger sur ses fondements.
L’humanisme aux prises du réel
Autrement dit : si nous savons maintenant où l’Humanisme “s’arrête”, nous allons chercher à comprendre où est-ce que celui-ci commence. Ceci va nous permettre de penser ce courant hors de l’idéalité dans laquelle nous étions jusqu’alors enfermé pour le mettre aux prises avec le réel : comme une pensée politique. Dans nos précédentes recherches, l’Humanisme s’arrêtait à tout ce qui n’était pas humain : dans la hiérarchie vis-à-vis des objets ; la différence vis-à-vis des animaux ; tout en gardant une responsabilité qualifiable d’humaniste, par les valeurs qu’elle véhicule, par rapport à eux. Jusqu’ici nous avions donc pensé ce courant comme réalisation de l’Humanité et de notre lien à autrui. Nous nous demanderons donc, dans quelle mesure une situation nous aliénant jusqu’à l’inhumanité impossibilise-t-elle tout humanisme ?
Où commence notre humanité ?
Nous nous confrontons ici aux exemples les plus barbares : la guerre, le génocide, la manipulation, etc. Tout ce qui peut, d’une manière ou d’une autre, nous enlever notre humanité, de façon réversible (comme avec l’aliénation) ou non (l’inhumanité). Où commence notre Humanité ? Bien que nous gardions une nature humaine “biologique”, notre sentiment d’Humanité, dans un acte tel qu’un crime, est réprimé au point de nous “in-humaniser”. Cette perte de notre propre nature s’explique par la totale négation de la dignité d’autrui, conférée par cette même appartenance au genre humain. En réduisant ainsi son Humanité, nous détruisons le caractère inviolable de cette idée de l’ “Humanité” en général, et nous réprimons par conséquent la nôtre qui n’a, alors, plus de valeur.
Si la dignité est la première condition de possibilité de l’Humanité, nous avions vu avec Erasme qu’elle advenait aussi comme une individuation permise par nos relations et leur caractère éducationnel. Mais pour qu’une éducation et des relations puissent s’épanouir, il faut un cadre matériel et institutionnel permettant cet épanouissement. Pour qualifier un tel état, nous pourrions parler de “paix”. Ce terme s’entend à la fois comme une paix “extérieure” : une situation dans laquelle se trouve un pays, un contexte permettant un fonctionnement politique normal. Un contexte tel, qu’il permet des relations apaisées, ou encore ce que traduit le sens “intérieur” de la paix : être bien avec soi-même, s’accepter. Dans ses deux dimensions, on retrouve des notions de sérénité, de bien-être ou encore de disponibilité. S’il y a des fondements nécessaires à l’Humanité, c’est donc tout ce qu’il n’y a pas dans une situation de guerre, ou lorsque l’on subit ou commet un crime : une considération de la dignité, mais aussi un cadre permettant une paix suffisante pour pouvoir s’épanouir et grandir avec ses relations de sorte à advenir à l’Humanité, à l’individuation par le discernement.
Où commence l’humanisme ?
De cette Humanité, où commence l’Humanisme ? Dans la volonté de s’accomplir en tant qu’humain. Dans un contexte que nous pourrions qualifier de “normal”, comme la paix, nous avons identifié des attitudes qui, loin de relever de l’inhumanité, ne sont pas humanistes pour autant. Pour les qualifier : nous avons parlé d’in-humanisme en utilisant le préfixe in- pour signifier un repli dans l’intériorité, un individualisme, une indifférence vis-à-vis d’autrui. Au contraire, une des facettes de l’humanisme est la volonté de s’accomplir pleinement en tant qu’être humain, notamment en cherchant à progresser moralement. Là où la dignité et le discernement étaient nécessaires à l’Humanité, l’Humanisme va advenir dans le respect et au travers de notre action. En effet, il y a dans l’effort librement consenti : et de la dignité, et du discernement ; consenti en ce qu’il respecte effectivement la dignité de son auteur, mais aussi libre en ce qu’il ne peut être exécuté, en conscience de sa portée, qu’au moyen du discernement qui nous rend responsable.
Si l’Humanité est nécessaire à l’Humanisme — cette tradition ayant “attrait” à l’Humain parmi d’autres —, nous voyons en quoi notre définition de ce courant de pensée découle de celle de notre nature, en ce qu’il en est une amplification, une réalisation au travers du respect et de la responsabilité. Nous pouvons alors repenser notre schéma du 13 Octobre, alors présenté lors de l’« Apéro MUMA » traitant des perspectives de l’Humanisme contemporain.

Sans ce fondement d’Humanité, il devient donc impossible d’être humaniste. Si, en tant que tels, nous avons à nous soucier de l’in-humanisme présent — l’indifférence et l’égoïsme de nos sociétés en paix — ; ne devrions-nous pas être encore plus inquiétés par les manifestations de l’inhumanité dans le monde ? Cette dimension politique de l’Humanisme, critique et engagée, tout en restant neutre, lui est donc vitale : car s’il ne défend pas l’Humanité, comment peut-il même exister ? Il faudra donc penser les différentes dimensions que devra prendre cet engagement, en considérant les conditions de possibilités de l’Humanité comme des droits.
Dénoncer, lutter contre les manifestations de l’inhumanité, contre nos tendances in-humanistes, ne serait-ce pas là… notre devoir ?
William FALTOT